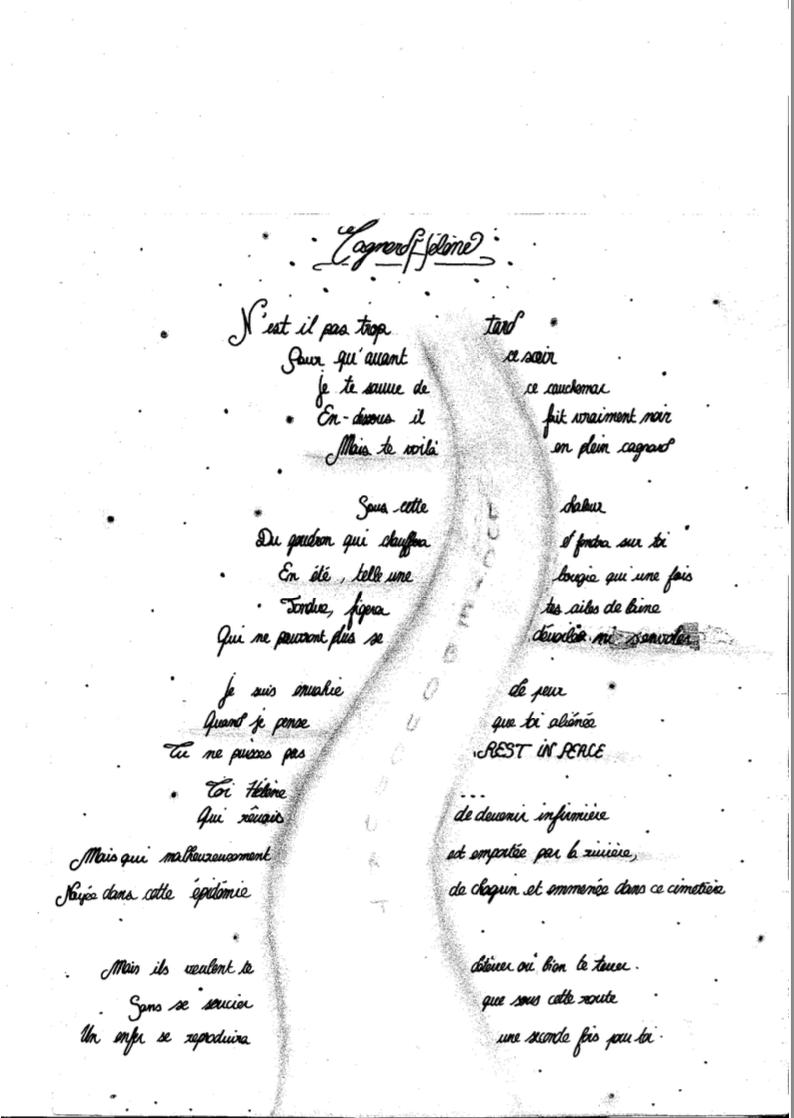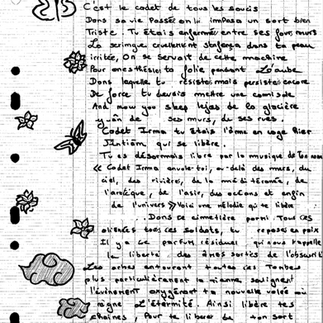- Alexandra Sobczak
- 28 juin 2023
À l’annonce de cette nouvelle, nous avons été alertés par Christian Gasch, très soucieux de l’avenir du patrimoine de sa ville natale. Il est vrai que sur l’instant nous avons cru à une blague de mauvais goût, mais hélas pas du tout.
Nous pensons sincèrement que la ville ne doit pas se dessaisir de ce patrimoine emblématique et, bien évidemment, nous nous joindrons à tous les neversois qui seront contre ce projet. Et si vraiment la municipalité campe sur ses positions, alors nous veillerons à ce que le repreneur propose un projet digne de ce patrimoine qui règne sur la ville de Nevers depuis plus de 600 ans.

Voici son alerte :
Fin 1398, Philippe de Bourgogne décide d’aménager les Halles de Nevers et, à la demande de ses habitants, accepte la construction à l’un des angles du bâtiment « d’un reloige pour savoir les heures du jour ».
27 juin 2023, le maire Denis Thuriot en son Conseil Municipal fait acter le déclassement et la désaffectation de cette tour de l’horloge, appelée le Beffroi, pour permettre sa mise en vente.
"C’est un bien atypique qui peut intéresser," argumente-t-il.

Atypique ? Pas vraiment ! C’est plutôt une construction typique de la fin du moyen-âge et un monument patrimonial qui a observé, du haut de ses 42 mètres, la vie des neversois depuis près de 625 ans !
Le quartier du Beffroi était à l’époque de la construction de l’édifice un lieu d’entrepôt et d’abattage des animaux avant la mise en vente de leur viande par les bouchers, première corporation officiellement reconnue à Nevers le 28 avril 1400. D’ailleurs l’une des rues adjacentes porte toujours actuellement le nom de « rue des boucheries ». C’était aussi avant les travaux de rénovation du quartier une véritable cour des miracles où il n’y avait pas que le bétail qui était mis à mort...
Trois ans après le début des travaux effectués par le maître-maçon Jean des Amognes la tour surmontée de sa girouette était visible depuis l’autre rive de la Loire. Dans le bâtiment principal les Halles étaient occupées par les bouchers et la partie supérieure par le tribunal du baillage.
Lors de la réception des travaux, la tour était déclarée mal construite et impropre à recevoir une horloge et sa cloche ! Il a fallu attendre le 6 mars 1439, l’autorisation par lettres patentes du placement de l’horloge, et la fin du même mois pour que la cloche, fondue en l’église Saint-Etienne, trouve sa place au somment de l’édifice. La commission nationale du patrimoine et de l’architecture vient d’ailleurs d’être sollicitée pour le classement de la cloche et de ses accessoires au titre des Monuments historiques. Un violent orage détruisit la tour et l’horloge en 1456, mais cette catastrophe entraina la reconstruction et l’embellissement du clocher en y ajoutant deux cloches sonnant les quarts et les demies.
Au cours des siècles de nombreux travaux viendront consolider le beffroi voire modifier son aspect, avec parfois pose de symboles révolutionnaires à son sommet (coq, bonnet phrygien, canon...)
Le XIXe siècle aura été celui de l’abandon du monument, l’escalier extérieur qui menait au tribunal détruit, maisons et boutiques « s’incrustant » dans le bâtiment, le beffroi devenant un grenier à rats...Il faudra attendre la fin du siècle pour que Massillon ROUVET envisage de restaurer le beffroi, de le dégager de toutes ses verrues afin d’embellir la Rue du Commerce.

Depuis octobre 2016 la Municipalité et le Département ont effectué de nombreux et coûteux travaux de rénovation (plus d’un million d’euros), alors comment ne pas s’étonner de cette décision d’abandon du monument historique à la loi du marché ! Le patrimoine architectural de Nevers est très vaste et comporte des merveilles. S’il est vrai que cette tour de l’horloge n’est pas l’un de ces plus spectaculaires édifices, il n’en demeure pas moins que nous avons envers elle un devoir de protection et de sauvegarde. Sa longue histoire est la nôtre et son clocher un repère spatial, et temporel ! du centre-ville. Même si sa disparition n’est pas programmée, sa vente à un propriétaire privé ne l’exclut pas. Alors nous devons tout faire pour éviter que « La malheureuse histoire d’un clocher » écrite par Jean Planchon en 1943 ait pour épilogue sa destruction.